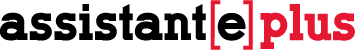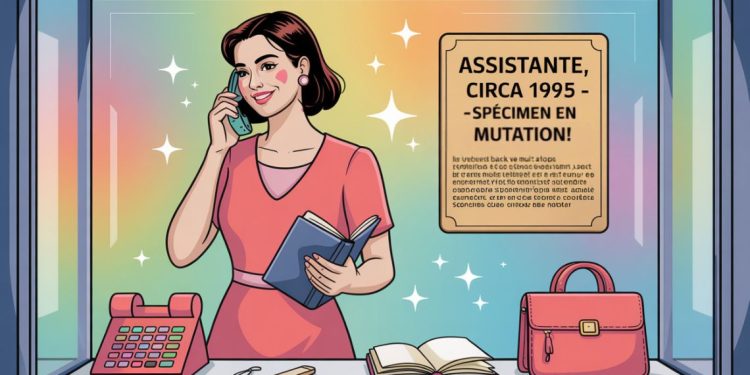Votre panier est vide.
L’assistante : toujours le visage discret d’un stéréotype sexiste ou d’un métier en transition silencieuse ?
Le mot claque comme une évidence : « assistante », c’est une femme. Pas besoin de réfléchir. On voit un tailleur sobre, un sourire de façade, un agenda parfaitement tenu, une main qui fait passer le café. Pourtant, derrière cette image figée, un débat s’ouvre : entre stéréotype coriace, évolution invisible et résistances culturelles, le métier d’assistante révèle une tension entre héritage et mutation. Et si ce visage discret n’était pas seulement celui d’un stéréotype, mais aussi celui d’un champ de forces contradictoires ?
Temps de lecture : 8 minutes
Le grand rôle de l’assistant(e) dans la société d’hier et d’aujourd’hui
Ils sont partout. On les entend, on leur parle, mais on les voit rarement. Les assistant(e)s font tourner les entreprises, sans tambour ni trompette. Leur rôle est souvent invisibilisé, pourtant il est central. Et dans l’histoire de l’émancipation des femmes, il a même été décisif. Pour comprendre l’impact historique et actuel de cette profession trop souvent reléguée à l’arrière-plan, nous avons rencontré Marianne Vollet Gless, consultante en parcours socioprofessionnel et spécialiste de l’histoire du secrétariat.
Dire que le métier de secrétaire a permis l’émancipation des femmes, c’est un pléonasme ?
Il faut d’abord resituer le métier. Le secrétariat naît avec l’apparition de l’écrit et des structures étatiques organisées autour des archives. Pendant des millénaires, l’accès à la lecture et à l’écriture était interdit aux femmes. Le mot « secrétaire » désignait alors des postes de confiance, proches des rois ou des puissants, réservés aux hommes.
Mais tout change au XXe siècle. L’industrialisation et la division du travail simplifient la communication administrative. L’arrivée des machines à écrire, la démocratisation de l’équipement de bureau, la gestion documentaire : autant de transformations qui rendent ces tâches plus accessibles. Les femmes sont alors massivement recrutées pour la dactylographie, la sténodactylo, la correspondance client… Autant de tâches à la fois techniques, répétitives et stratégiques. C’était un moyen de sortir du travail manuel ou domestique, souvent pénible, mal payé et socialement peu valorisé. Le secrétariat devient alors une voie d’émancipation professionnelle, surtout pour les femmes des classes populaires.
Le regard porté sur les secrétaires, c’était un miroir du regard que la société portait sur les femmes ?
Oui, mais c’est plus complexe qu’on ne le croit. Dans le privé, beaucoup d’hommes accédaient à des postes de direction sans maîtriser les rouages administratifs. Ils avaient donc besoin de collaboratrices capables de tenir la boutique sur le plan réglementaire. Cela créait une relation ambivalente : la secrétaire devait être irréprochable, compétente, mais aussi disponible — parfois trop.
Il faut aussi casser les clichés. Celui de la « jolie assistante qu’on emmène en voyage et qui devient la maîtresse » est un pur produit du machisme collectif. Dans les années 60, l’imaginaire Play-boy et la culture « pornochic » ont largement nourri cette caricature. Mais sur le terrain, les profils et les compétences étaient bien plus variés. Ce fantasme tenace a surtout servi à masquer l’utilité réelle de ces postes.
Pourquoi ce métier a-t-il été si souvent sexualisé dans l’imaginaire collectif ?
C’est un stéréotype masculin, et malheureusement, il repose en partie sur des réalités constatées. À l’époque, beaucoup d’employeurs cherchaient à payer le moins possible. Les femmes acceptaient des salaires plus faibles. Et dans le couple professionnel homme-femme, les dérapages n’étaient pas rares.
Dans les années 60, l’exode rural battait son plein. Les jeunes femmes fuyaient les travaux agricoles ou ménagers pour un emploi plus propre, même mal rémunéré. Résultat : elles devenaient des cibles. Le fantasme de la secrétaire jeune, docile et accessible sexuellement était omniprésent dans la culture populaire. Et les fameuses « promotions canapé » n’étaient pas des mythes. J’ai moi-même été témoin — voire cible — de ces dérives. Ce n’était pas « normal », mais c’était largement toléré.
Comment expliquer que ce métier, jadis prestigieux quand exercé par des hommes (scribes, clercs, secrétaires du roi…), ait été si vite dévalorisé une fois investi par les femmes ?
C’est un mal très français. En Allemagne, par exemple, le rapport hiérarchique est moins méprisant. En France, tout ce qui relève du soutien administratif est vite considéré comme subalterne. Le mot « fonctions support » est arrivé dans les années 90, comme pour dire : « ce n’est pas le cœur de métier ».
Et pourtant, le secrétariat a longtemps été stratégique, central, reconnu. Mais avec la division du travail, on a créé une échelle hiérarchique qui va de « l’employé de photocopie » au « chargé de mission » ou « secrétaire de direction ». Ce glissement a permis une lente dévalorisation. Un jour, un président de chambre de commerce m’a même dit : « On n’aura plus besoin de toutes ces petites mains, les machines feront le boulot. » Ce fantasme technologique a contribué à enterrer la reconnaissance de la profession.
Pourquoi y a-t-il encore si peu d’hommes dans ces métiers ?
C’est une question de représentation, mais aussi d’évolution. Le métier a changé : il s’est diversifié, spécialisé. Beaucoup d’hommes se dirigent vers des BTS de gestion ou de communication, mais ne se définissent pas comme « secrétaires ». Pourtant, ce sont les mêmes compétences, les mêmes tâches, parfois sous un autre titre.
Mais il faut être honnête : dès qu’un métier commence à se dévaloriser ou à se fragiliser, les hommes s’en éloignent. Et aujourd’hui, avec l’essor de l’intelligence artificielle et l’automatisation, les tâches rédactionnelles — donc une grande partie du métier d’assistant — sont menacées. Cela n’aide pas à attirer du monde, quel que soit le genre.
Est-ce que le métier d’assistant(e) va vers plus d’égalité ?
Oui, mais rien ne se fera sans combat. Il faut que les femmes se battent, que les syndicats se réveillent. Parce qu’on est à l’aube d’une nouvelle révolution technologique qui risque, encore une fois, de reléguer dans l’ombre toutes les professions rédactionnelles ou administratives. L’assistanat de direction est concerné, le journalisme aussi, et bien d’autres encore.
Propos recueillis par Ismaella Diallo
Un héritage sexiste profondément ancré
Le métier d’assistante n’a pas toujours été féminin. Jusqu’à la fin du XIXᵉ siècle, les secrétaires étaient presque exclusivement des hommes, souvent destinés à gravir les échelons du pouvoir. Mais l’arrivée de la machine à écrire dans les années 1860‑1870 change la donne. Les employeurs découvrent dans les « doigts fins » des femmes un prétexte commode pour confier ce travail technique à des salariées moins coûteuses et supposément plus dociles. La dactylographie devient l’antichambre d’une féminisation accélérée du travail de bureau. Une première onde de choc, jamais vraiment démentie.
Aujourd’hui, l’héritage est toujours là. En 2025, selon les dernières données de l’Insee, 95 % des secrétaires dans le secteur privé sont des femmes. Le chiffre grimpe à 97 % chez les secrétaires médicales, et il atteint également 97 % dans la fiche métier officielle de l’Onisep. La Dares, déjà en 2014, parlait de profession « quasi exclusivement féminine ». Dix ans plus tard, rien n’a changé.
Des mécanismes puissants qui entretiennent la division sexuée
Quatre grands ressorts expliquent la persistance de cette domination féminine :
- Orientation et formation : les filières tertiaires du lycée professionnel (gestion-administration, secrétariat, accueil) restent massivement choisies par des adolescentes. L’effet boule de neige se poursuit en BTS et en apprentissage, dans un entre-soi féminin qui s’auto-entretient.
- Organisation du travail : l’assistanat repose sur des tâches invisibles (gestion de planning, filtrage, coordination, « care » organisationnel) peu reconnues comme compétences stratégiques. Ce rôle périphérique, souvent mal rémunéré, décourage les candidats masculins formés à viser la verticalité hiérarchique.
- Langage et représentations : le féminin automatique dans l’intitulé (« assistante ») fixe l’imaginaire. Même lorsque les titres se modernisent (« office manager », « bras droit », « executive assistant »), la fonction reste majoritairement féminine tant que le contenu du poste implique du soin ou du service.
- Dévalorisation symbolique : la sociologie le martèle depuis des décennies… dès qu’un métier se féminise, il perd en prestige et en rémunération. Le secrétariat illustre ce cercle vicieux : plus il se féminise, moins il attire, et plus il se banalise.
Des contrepoints à ne pas ignorer
Mais la mécanique n’est pas totalement immobile. Des signaux faibles dessinent une possible transition :
- Des hommes dans la fonction : certains hommes choisissent volontairement le métier d’assistant, notamment dans les grandes entreprises. Témoignages à l’appui, ils évoquent un poste d’observation privilégié, une proximité avec les centres de décision, et parfois une reconnaissance accrue. Leur présence, encore marginale, est perçue comme atypique… mais pas absurde.
- Des missions plus stratégiques : la numérisation a transformé une partie des tâches classiques. Moins de frappes, plus de coordination, de gestion d’événements, de suivi de dossiers transversaux. Dans ce cadre, des profils plus variés émergent, et les lignes de genre commencent (timidement) à bouger.
- Des politiques de mixité embryonnaires : quelques lycées professionnels expérimentent des dispositifs de diversification de genre dans les filières tertiaires. Des campagnes locales incitent les garçons à envisager des métiers d’assistanat. Le ministère du Travail appuie certaines initiatives de mentorat mixte.
- Une revalorisation discrète du « care » au bureau : certaines entreprises commencent à reconnaître la charge émotionnelle et relationnelle comme un levier de performance. Anticiper, fluidifier, absorber les tensions internes devient une compétence. Et dans ce domaine, les assistantes, qui font ce travail depuis toujours, sont enfin regardées avec un œil plus stratégique.
Une tension vivace entre stéréotype et mutation
Le métier d’assistante se tient donc à un carrefour. Il reste, dans les faits, l’un des bastions les plus solides de la division sexuée du travail. Mais il abrite aussi, dans ses marges, des dynamiques nouvelles qui bousculent les assignations habituelles.
Faut-il alors dénoncer ce métier comme un symbole du sexisme professionnel ? Ou reconnaître qu’il pourrait incarner, demain, une forme de compétence relationnelle centrale dans l’économie de service ?
Probablement les deux à la fois.
Le problème ne réside pas dans la fonction elle-même, mais dans ce que la société continue à en attendre : de la loyauté, de la disponibilité, du soin — sans jamais les nommer, sans jamais les payer, sans jamais les rendre visibles. Tant que ces qualités resteront dans l’angle mort du pouvoir, ce ne seront pas les femmes qui devront changer de métier, mais le métier qui devra changer de place.
Margaret Maruani — Travail et emploi des femmes
(5e édition, La Découverte, coll. « Repères »)
Une synthèse claire et percutante sur les inégalités dans le monde du travail. Elle explique notamment comment les métiers dits « féminins » se construisent historiquement comme des zones de sous-emploi et de sous-valorisation.
Danièle Kergoat — Se battre, disent-elles
(La Dispute, 2012)
Une référence en sociologie du genre. Elle explore notamment les logiques de la « segmentation sexuée » du travail et l’invisibilité des compétences dites féminines.
Dominique Méda — Le travail : une valeur en voie de disparition ?
(Champs, Flammarion)
L’auteure revient sur la valeur symbolique attribuée au travail et sur la manière dont celle-ci est profondément genrée.
Et les Éditions de la découverte sur leurs revues et livres sur le genre.
Média leader sur les fonctions d’assistanat et d’Office management
Assistant(e) Plus se décline en un écosystème informationnel complet : magazine trimestriel, site web, newsletters thématiques, média social et événements.
Il accompagne assistant(e)s de direction, métiers et fonctionnel(le)s, office managers, etc. (plus de 2 millions de professionnels décisionnaires ou prescripteurs en France et dans la francophonie) dans l’évolution de leurs métiers en offrant un contenu éditorial riche composé de dossiers, conseils, fiches pratiques, et une sélection de prestataires pour une gestion optimisée de leur métier.



ASSISTANT(E) PLUS
© 2025 - Blitzzz Media - Assistant(e) Plus - Tous droits réservés.